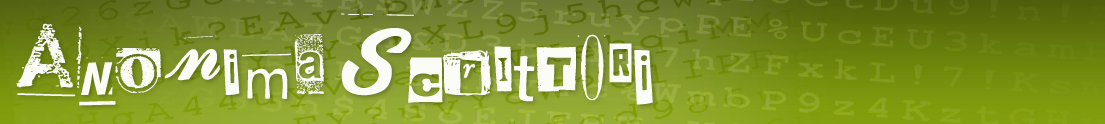Canal Mussolini, Antonio PennachiPar Cécile Pellerin, le mardi 31 janvier 2012 à 21:29:14 - 0 commentaire
ISBN : 9782867465857
Prix eBook :
Prix papier : 23 €
Pages : 504
Editeur : Liana Levi
Traduit de : Italien
Traduit par : Nathalie Bauer
La famille Peruzzi valait bien un tel roman. Plus de 500 pages pour suivre l'épopée tragi-comique sur près d'un demi-siècle, d'une vaste tribu, dans l'Italie fasciste de Mussolini. Un récit foisonnant, une véritable leçon d' histoire également racontés tel un conte , plein de vie, de comédie, de bavardages et de digressions, à la fois enlevé et précis, drôle et touchant même si, ça et là, compte-tenu de la longueur, le lecteur s'agace un peu, s'égare aussi parfois et frôle l'ennui, perdu dans certains détails historiques mal connus du lectorat français.
Le narrateur, petit-fils dont l'identité exacte ne sera connue qu'en fin de roman, raconte, dans un style vif, proche du langage parlé, l'histoire de sa famille, de ses grands-parents et de leurs dix-sept enfants (pittoresques et savoureux). Une famille d'agriculteurs du nord de l'Italie contrainte de quitter son village, chassée par le comte Zorzi Vila (propriétaire terrien) et le quota 90 (réévaluation de la lire italienne, instaurant un taux d'échange lié à la livre sterling de 92,46 lires pour une livre sterling), qui l'appauvrissent.
« Nu comme des vers. Une main devant et une derrière, voilà à quoi ils nous avaient réduits. A l'état de crève-la-faim. » La construction du canal Mussolini sera leur salut. En effet, Mussolini permet à ceux qui aident la patrie à construire ce canal, d'obtenir un terrain et de devenir enfin propriétaires. Aussi, c'est plus de 30 000 paysans du Nord (dont la famille Peruzzi) qui vont alors émigrer dans la région de l'Agro Pontin, entreprendre l'assèchement des marais, creuser le canal et ériger des villes nouvelles.
Le récit de cette période se lit comme une aventure enthousiasmante, parsemé de détails savoureux et réellement inédits pour qui connait peu l'histoire de l'Italie. L'exode des familles, l'assèchement des marais passionnent véritablement et laissent au lecteur la douce impression de s'enrichir de connaissances, l'air de rien, sur un ton toujours amusé et gai. Un moment de lecture réellement heureux ; sans doute le meilleur du livre.
C'est de la même manière, d'ailleurs, que le narrateur évoque l'adhésion de la famille au fascisme. De manière désinvolte, presque amusée, il évoque le passage des siens, du rouge au noir, sans états d'âme ni honte ou remords. La famille Peruzzi devient fasciste plus par amitié, fidélité (parce qu'elle a connu Mussolini jeune et surtout son numéro deux, Rossoni, un ami de la famille) que par réelle conviction politique.
C'est un parti, à ses débuts, pas forcément plus mauvais ou liberticide que les autres partis jugés plus démocratiques, selon le narrateur : « Il avait un programme de gauche quand il a fondé le Fascio. »Très populaire, il rencontre l'adhésion des petites gens et lorsque le parti promulgue des lois antisémites, personne ne s'offusque : « Fin 1938, les Juifs étaient hors la loi en Italie, ce n'étaient plus des citoyens comme les autres [… je vais être franc, cela n'a eu aucun effet sur ma famille. Comme sur le reste du peuple italien, soyons clairs. »
Et bizarrement, cette attitude politiquement incorrecte, hors contexte, ne choque pas vraiment car toujours empreinte d'autodérision et de moquerie, d'honnêteté remarquable. Comme si, finalement, cette famille menait son existence sans rien dramatiser, comme détachée des événements historiques ou plutôt comme resserrée sur elle, presque en autarcie.
Comme pour se protéger. Une attitude de survie qui empêchera l'éclatement de la famille jusque dans les heures les plus sombres et donnera vie, quelque part à l'auteur : « Qu'il soit bon ou mauvais, ce livre est la raison pour laquelle je suis venu au monde. »
Une unité dont les difficultés pour la maintenir, jaillissent du texte lui-même. Par ses anecdotes et nombreuses digressions, avec un style foisonnant, parfois excessif, l'auteur exprime sans doute tous les détours et aléas, subterfuges, concessions et tiraillements pour conserver la famille en l'état, lui donner une raison d'être. Et il y réussit, d'ailleurs. Avec brio, fougue et beaucoup de respect, au final.
Dialogue avec l'écrivain italien Antonio Pennacchi
Romancier et ancien ouvrier qui tient l'écriture pour un droit de mémoire
Saïd AFOULOUSL'opinion : 18 - 02 - 2011
« Je voudrais être traduit en arabe », nous a déclaré l'auteur au cours d'un entretien lundi 14 février. C'est la première fois qu'il vient au Maroc et la première fois aussi qu'il foule le sol d'Afrique.
« J'ai visité Marrakech, mais je préfère de beaucoup Casablanca…».
Avec quelques bribes de français, il parvenait difficilement à exprimer ce qui lui tenait le plus à cœur au cours de l'entretien qu'il nous a accordé à l'hôtel où il séjournait à Casablanca. La très jeune Floriane Merlino, de la délégation de l'Institut italien de Rabat a bien voulu jouer le rôle périlleux de l'interprète dans un entretien autant passionnant que chaotique.
Car chez Pennacchi, les bribes de français sont vite envahies, évacuées par les flots diluviens d'italien. Il ne fait pas de la communication sobre, fonctionnelle, ne parle pas à demi mots. On dirait qu'il parle avec ses tripes. Le rythme débordant malmène la très jeune interprète. Heureusement, des plages de grands rires s'intercalent dans ces échanges laborieux.
L'homme est intarissable. A chaque fois c'est une coulée verbale, une avalanche de digressions, enchaînements, émotions. Ce n'est pas un bavard, il ne parle pas pour ne rien dire. Par contre c'est un puncheur jusqu'au-boutiste quand il s'agit d'aller au bout de ses idées.
Il aime à répéter : « En écrivant, j'ai boxé, le plus important ce n'est pas de vaincre mais de lutter de toutes ses forces, c'est juste ça qui importe».
Ayant passé toute sa vie travaillant dans les usines, dans sa jeunesse il connaît des errements, adhère à un parti fasciste avant de s'engager dans le parti communiste. De cette vie, il parle dans son autobiographie « Il fasciocommunista » (Le fasciste-communiste) parue en 2003, texte traduit en français sous le titre « Mon frère est fils unique » et adapté au cinéma.
Pennacchi est né en 1950 dans la ville de Latina, banlieue sud de Rome, à 70 kms, dans une famille d'origine rurale pauvre. A cause de la pauvreté, il a été amené à travailler en usine, encore enfant, à l'âge de 13 ans, soit à partir de 1963 et n'a quitté l'usine qu'en 1999, soit 36 années de travail manuel.
Il arbore tout le temps une casquette, emblème de sa classe d'ancien ouvrier.
Homme de principe, il dit ne jamais trahir sa classe, la classe des ouvriers et le travail manuel. A ce titre, il serait à l'opposé de Rimbaud quand le génial poète s'insurge en écrivant : « La main à plume vaut la main à charrue, quel siècle à mains ! ».
Pour Pennacchi, l'intelligence, toute l'intelligence de l'homme provient de la main.
« L'intelligence n'est pas seulement dans la tête, elle est dans la main »
Par rapport aux grands écrivains italiens comme Moravia ou Eco, « de grands intellectuels issus de la bourgeoisie », il se considère comme un intellectuel de la classe ouvrière sans pour autant en faire une idéologie.
Dans son nouveau roman, « Canal Mussolini », Pennachi raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui construisent, de leurs mains, une nouvelle ville au terme d'un extrême labeur. Il s'agit d'une épopée de peuplement d'un territoire marécageux, sorte de désert inhospitalier « peuplé de serpents, moustiques, malaria et paludisme, avec une forêt impénétrable… ». De ce « désert de malaria et de paludisme», selon l'expression des géographes, surgira la ville de Latina, 20 ans avant la naissance de l'auteur.
L'œuvre est donc une reconstitution méticuleuse de l'histoire de l'exode massif des populations du nord de l'Italie, de la Vénétie notamment, au début des années 30 sur l'appel du régime fasciste de Mussolini.
L'histoire commence ainsi dit-il : « A cause de la faim, seulement à cause de la faim… »
Il ajoute : « S'il n'y avait pas la faim, mes parents n'auraient jamais quitté leur terre au nord dont ils connaissaient toutes les rides et les moindres recoins »
Enfant, il avait toujours vécu dans un univers rural parmi les animaux et c'est une cousine, fille de son oncle préféré, qui lui avait appris à lire et à écrire à l'âge de six ans.
« L'un des livres qui m'a le plus frappé dans mon enfance et que je n'avais cessé de relire, plus de 27 fois, c'est « L'Île mystérieuse » de Jules Verne ».
Juste après avoir su lire et écrire, il dit avoir eu un appel intérieur, très fort, de devoir écrire sur l'exode et les souffrances de sa famille migrante, ses grands parents et ses parents, ses oncles.
« C'est comme une condamnation. Je n'ai cessé de faire la sourde oreille à cet appel. Lire et étudier étaient simples plaisirs pour moi, mais écrire c'est la plus grande douleur que je tentais d'éviter d'ajournement en ajournement »
Ayant été un enfant rebelle envers les siens, père, mère, autorité, Etat, ayant été engagé dans un parti fasciste puis le parti communiste, ayant été syndicaliste aussi, sa plus grande aspiration une fois parvenu au milieu de la trentaine, c'était de se réconcilier avec les siens, avec son père surtout, n'ayant jamais été un « bon fils ». Et c'est juste après la mort de son père en 1986 qu'il a commencé à écrire plongeant dans l'inimaginable « corvée ». Un premier roman, « Mammut », parait en 1994 et remporte le prix del Giovedi. Son autobiographie « Il Fasciocomunista » (2003) décroche le Premio Napoli.
Avant d'écrire le roman de l'exode « Canal Mussolini », il avait écrit, dit-il, des essaies pour essayer de prendre son élan en reconstituant tout un matériau historique et avoir une vision personnelle avec force détails nouveaux. Pour se documenter davantage, il avait interviewé longuement les proches parents, les oncles, les tantes pour essayer de glaner le maximum d'informations.
« Cette histoire se passe en 1930, vingt ans avant ma naissance, pourtant moi j'étais déjà dans le corps de mon père pendant qu'il travaillait dans les champs. Bien que bel et bien mort depuis 25 années maintenant, mon père est toujours en moi. Dans la littérature sud-américaine et dans l'anthropologie culturelle de Claude Lévi-Strauss, on appelle ce genre de chose du magico religieux. Pour moi, ce n'est pas du tout magique, pour moi c'est la simple réalité »
Dans toute l'histoire racontée tout est authentique, dit-il, rien qui ne soit bel et bien un fait avéré. Le seul ajout c'est la manière de raconter et de relier les différents pans du récit. Celui-ci s'achemine comme une confession pour dévoiler le mal, en n'hésitant jamais à éclairer tous les coins d'ombre, sans complaisance, attisant à l'envi le sentiment de honte, mais aussi faisant advenir le sentiment d'amour, de pitié, de compassion, en un mot l'empathie.
« Le meilleur dans une narration, qui la rende poignante, c'est le degré d'empathie ».
Parler du mal, c'est l'exorciser, nous en délivrer, dire enfin : jamais ça, plus jamais !
Quand il voit des migrants marocains en Italie, il dit se reconnaître en eux :
« C'est parfaitement moi quand j'étais jeune. La migration, les Italiens ont connu ça. Dans mon livre, je parle des souffrances des migrants et des injustices qu'ils subissent. Quand je voie la haine religieuse dans les yeux d'un jeune musulman, je reconnais ma propre haine contre les riches quand j'étais jeune ».
Il dit que le plus important dans le livre ce sont les personnages féminins.
« L'histoire d'énorme progrès, c'est l'histoire de notre femme. La vraie force c'est la force de notre femme ».
Quand il a terminé le livre, il s'est dit : « Enfin je peux aujourd'hui mourir en paix avec les miens, je peux les rencontrer face à face, maintenant que mon devoir de témoigner pour eux est bel et bien terminé ».
Quand il a reçu le prix Strega, ce qui lui a fait le plus plaisir c'est d'entendre des copains anciens ouvriers et autres gens de Latina dire : « Nous avons gagné le prix ! »